Infections transmissibles sexuellement et par le sang : la protection oui, mais pour qui?
14 novembre 2023
Malgré les avancées scientifiques qui marquent régulièrement l’actualité, le Canada encaisse une croissance sans répits du nombre de cas d’infections transmises sexuellement et par le sang (ci-après, ITSS) depuis 2010 (Rapport sur la surveillance des infections transmissibles sexuellement au Canada, 2019). Pourtant, la prévention de chacune d’elles requiert des mesures de protection relativement simples. Suffit que l’information concernant le risque réel soit communiquée aux partenaires. Mais… la peur du rejet n’épargne personne, et la stigmatisation liée est encore importante.
Le droit criminel, par son mandat de base, est un domaine qui ne fait certainement pas l’unanimité et dont le développement peine parfois à passer outre la stigmatisation de son objet. Cela dit, considérant que les politiques de santé publique peinent à freiner la propagation des ITSS, le droit criminel doit s’affirmer plus strictement contre la violence sexuelle qui émerge de la non-divulgation intentionnelle des ITSS. Tout comme la non-judiciarisation des cas d’agressions sexuelles de manière générale, il est évident que les cas spécifiques de fraude ayant vicié le consentement étant effectivement judiciarisé ne représentent qu’une infime partie de la réalité. Voyons où en est le droit aujourd’hui.
Cadre d’analyse en vertu du Code criminel
Quand une question concernant le consentement à une activité sexuelle est soulevée devant la Cour, cette dernière doit l’évaluer en suivant deux grandes étapes :
- L’analyse du consentement à l’activité sexuelle en question, qui nécessite notamment de définir précisément quelle était cette activité;
- La validité du consentement ainsi obtenu.
1. Analyse du consentement à l’activité sexuelle en question
D’abord, l’art. 273.1 (1) du Code criminel :
Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
La Cour suprême du Canada a récemment décidé que c’est à ce stade que doit avoir lieu l’analyse du consentement au refus/retrait du condom pendant une relation sexuelle (R c Kirkpatrick, 2022 CSC 33). Effectivement, on considère désormais clairement qu’un contact physique protégé par un préservatif est fondamentalement différent d’un contact peau à peau et ce, même sans considération des risques afférents à l’absence de protection (para. 75). Simplement : une caresse par-dessus les vêtements est bien différente d’une caresse sous les vêtements. Le même principe doit être appliqué dans le cas du condom (para. 44). D’ailleurs, la Cour n’hésite pas à mettre en lumière un parallèle auquel les principaux intéressés peuvent potentiellement s’identifier pour clarifier la différence fondamentale entre les deux actes :
« De fait, certains hommes affirment que c’est cette différence, celle d’une expérience physique qui n’est pas la même, qui explique pourquoi ils préfèrent ne pas porter de condom »[1]
Autrement dit, « you can’t have your cake and eat it too » …
2. Validité du consentement
Pour tout ce qui est prise en charge et acceptation des risques (protection contre les ITSS et les grossesses non-désirées principalement), on se déplace plutôt à l’article 265 (3) du Code criminel, que l’on analyse en deuxième lieu :
Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité. [Soulignement ajouté]
Interprétation judiciaire
C’est avec la décision R c Cuerrier, [1998] 2 RCS 371 (ci-après, R c Cuerrier) que la Cour suprême précise l’étendue de la fraude qui pourrait être considérée comme ayant criminellement viciée un consentement autrement valide. Toute supercherie ne doit pas y être incluse. Effectivement, sans la preuve d’une privation (sous forme de préjudice reconnu), le droit criminel ne prend pas en charge les tromperies dans le but de séduire un partenaire. Par exemple : Mentir sur son occupation ou fabuler sur ses intentions relationnelles. Moralement répréhensible certes, mais pas criminel (para. 52 et 72). Au niveau des ITSS cependant, c’est ici que ça se corse.
Effectivement, les deux critères qui doivent être remplis pour que ce type de fraude soit reconnu laissent place à beaucoup d’interprétation. D’abord, il est nécessaire de prouver qu’il y a eu malhonnêteté. Habituellement, l’omission de déclarer ou le fait de mentir sur la présence d’une ITSS quelconque suffit à ce premier critère. On y a aussi inclus tout acte de manigance servant à endommager le condom volontairement et sans le consentement du partenaire en question (R c Hutchinson, 2014 CSC 19, ci-après R c Hutchinson). Cela dit, c’est au niveau du deuxième critère que, généralement, les problèmes surviennent. Comme mentionné plus haut, la simple malhonnêteté ne suffit pas. Cette dernière doit entraîner une privation sous forme de préjudice réel ou, simplement, de risque important de préjudice. Le tout, sous forme de lésions corporelles graves (R c Cuerrier, para 128). Ces deux conditions sont sine qua non.
La question du virus de l’immunodéficience humaine
Pour l’évaluation spécifique de la non-dénonciation du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la Couronne doit faire la preuve prima facie d’une malhonnêteté (omission ou mensonge), comme pour tout type de fraude. Cela dit, la Cour suprême du Canada a développé le critère de la privation quelque peu différemment. Effectivement, elle précise que pour conclure qu’il y a un risque important de préjudice corporel grave dans le cas du VIH, il est nécessaire de conclure que l’activité sexuelle en cause comportait une possibilité réaliste de transmission (R c Mabior, 2012 CSC 47, ci-après Mabior). On ajoute également qu’une fois ces deux étapes rencontrées, la partie défenderesse peut néanmoins nier l’existence d’un préjudice en prouvant que la personne accusée avait, au moment des faits, une charge virale faible ou indétectable ET qu’un condom a été utilisé. À ce point, on considère alors qu’il n’y a plus de possibilité réaliste de transmission et donc, plus de risque de préjudice.
La plus haute cour du pays s’est prononcée à deux reprises (Mabior et R c D.C., 2012 CSC 48) : la non-divulgation légale d’une atteinte au VIH nécessite une preuve que la charge virale de la partie défenderesse est faible ET que le port du condom a été respecté.
Mais c’est ici que les ennuis commencent. Dès 2012, les tribunaux du pays ont interprété la « possibilité réaliste de transmission » de manières différentes de sorte qu’une zone grise existe quant à l’obligation de porter un condom malgré une charge virale faible ou indétectable (la jurisprudence n’est pas claire quant au niveau suffisant non-plus). Plusieurs juges ont, depuis, considéré qu’une charge virale faible ou indétectable à elle seule suffit pour conclure qu’il n’existe pas de possibilité réaliste de transmission du virus. À titre d’exemple, voici quelques décisions rendues depuis l’arrêt Mabior :
- R v J.T.C., 2013 NSPC 105 (ci-après, R c J.T.C.) : Il est admis que l’accusé n’a ni divulgué son affection au VIH, ni porté de condom au moment de la relation sexuelle en question. Cela dit, puisque son corps contrôle naturellement le virus à une charge virale faible, il est acquitté considérant l’absence de risque réaliste de transmission.
- R v Felix, 2013 ONCA 415 : Malgré l’absence de preuve quant à la charge virale de l’accusé, il est déclaré que le non-port d’un condom est suffisant pour émettre une déclaration de culpabilité.
- R v WH, 2015 ONSC 6121 : Mabior continu d’être appliqué à la lettre, on requiert donc à la fois le port d’un condom et une preuve d’une charge virale faible.
- R c Thompson, 2018 NSCA 13 : La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse réaffirme que le port du condom OU la prise d’antiviraux assurant le maintien d’une charge virale faible est suffisant (critère un peu différent de celui de R c J.T.C.). La Cour de première instance avait ouvert la porte à la possibilité qu’un préjudice psychologique puisse remplir le critère de privation, nécessaire pour conclure à une fraude. Cela dit, la Cour d’appel est ferme à ce sujet : seulement les préjudices physiques doivent être considérés à ce niveau.
- R v Murphy, 2022 ONCA 615 : Considérant l’évolution de la science depuis Mabior, la Cour conclut qu’une charge virale indétectable est suffisante pour exonérer l’accusé qui n’a eu qu’une seule relation sexuelle non-protégée sans divulguer son statut.
L’imprévisibilité du droit en la matière est particulièrement préoccupante, surtout considérant que des peines d’emprisonnement en découlent. Bien qu’une certaine tendance des dernières années semble indiquer que la preuve d’une charge virale faible, ou indétectable (à préciser…) suffira pour exonérer la personne accusée, la Cour suprême du Canada devra probablement se reprononcer avant que l’on ne constate une réelle uniformité.
Autre point à considérer : seuls les préjudices physiques sont acceptés comme constituant une privation, facteur essentiel pour établir que le consentement de la victime a été vicié. Considérant cela, comment réagiront les tribunaux si un plaignant se présente à la suite de l’endommagement volontaire du condom par sa partenaire? Aucun préjudice corporel ne découle de cette « fraude ». Cette situation représenterait exactement l’inverse des faits dans R c Hutchinson, où un homme a intentionnellement saboté le préservatif utilisé afin de forcer une grossesse à sa partenaire. La Cour suprême du Canada a classifié cette action de fraude vu le préjudice physique que représente une grossesse non-désirée chez la femme. Mêmes actions, différents genres, différentes conclusions?
Au-delà du VIH
Qu’en est-il des autres ITSS qui, comme le VIH, ne peuvent être guéries? La transmission négligente de l’Herpes simplex virus par exemple (ci-après, l’herpès), a aussi reçu un traitement imprécis de la part des tribunaux au Canada. Bien qu’en pratique, certains jugements comparent les conséquences modernes du virus avec celles du VIH d’aujourd’hui (voir notamment R c J.H., 2012 ONCJ 708), aucune cour n’a repris le critère du risque réaliste de transmission. Au contraire, toutes les décisions sur le sujet sont fondées sur un lien de causalité direct, et on va jusqu’à l’exonération de l’accusé en l’absence de ce dernier (R v C.B., 2017 ONCJ 545).
Il est généralement admis, dans les références jurisprudentielles récentes, que R c J.H. est le premier cas où la transmission de l’herpès a été analysée suivant le cadre moderne de la fraude ayant vicié le consentement de la victime. Dans ses motifs concernant la détermination de la peine, le juge fait les comparaisons suivantes :
« On the one hand, for example, even a properly fitted condom offers only imperfect if not uncertain protection. On the other, HSV-2 does not carry the same fatal potentiality contemplated in Mabior » (para 25)
Dans ce cas, l’accusé savait qu’il était probablement infecté et on reconnait qu’il a mis sa victime à risque de préjudices corporels, qui, en l’espèce, se sont matérialisés. Précisant avoir très peu sinon aucune jurisprudence sur laquelle se pencher, le juge ajoute :
« What is particularly important at this stage in the evolution of public education about herpes is that others come to understand that omitting to inform one’s partner of one’s HSV-2 infectivity is not merely bad judgement or an act of private immorality but a crime. » (para 26)
La Cour précise qu’il s’agit d’une « affaire test » (puisqu’elle considère que c’est la première fois qu’une telle situation est portée devant les tribunaux) et ajoute qu’il faut considérer les conséquences négatives d’une condamnation sur la citoyenneté de l’accusé (originaire du Royaume-Uni). La Cour qualifie la considération de cette conséquence comme étant au moins aussi importante que l’intérêt du public concernant la dissuasion de ce type de crime (para 32 des motifs de détermination de la peine, précités). Pour ces raisons, une absolution conditionnelle est octroyée. Cette décision a d’ailleurs été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario, bien que vivement critiquée neuf (9) ans plus tard par la même cour de première instance (R v Sawicki, 2023 ONCJ 378, ci-après Sawicki).
Cela dit, avant d’arriver à Sawicki, quelques autres décisions ont tenté d’établir une marche à suivre en la matière. Par chance, on s’en écarte maintenant. Effectivement, la décision R c J.J.T., 2017 ONCJ 255 par exemple, acquitte l’accusé sous motifs qu’en l’absence de preuve médicale, il lui est impossible de prouver hors de tout doute raisonnable le lien de causalité nécessaire. Jusqu’ici… ça va encore. Cela dit, les motifs sont plus difficiles à comprendre à partir du moment où le juge ajoute que même en présence d’un lien causal direct, d’une non-divulgation et d’une relation sexuelle non-protégée, il aurait tout de même prononcé l’acquittement. Effectivement, il précise que l’accusé, bien que non traité, ne pensait réellement pas être contagieux. De ce fait, il conclut en l’absence de malhonnêteté. Et ce, contrairement à ce qui avait été déterminé dans Cuerrier, soit que la simple omission doit être suffisante pour remplir la condition de malhonnêteté.
Finalement, la Cour de justice de l’Ontario s’est prononcée clairement sur le sujet en septembre 2023, via la décision Sawicki (cité précédemment). Cette décision promet de changer la manière dont les tribunaux aborderont la transmission du virus de l’herpès. C’est sans mâcher ses mots que le juge Fergus ODonnell critique la manière dont les tribunaux précédents ont traité du sujet, particulièrement dans l’affaire R c J.H.. Effectivement, dans l’affaire Sawicki, ce dernier a fait deux victimes, la deuxième en connaissance de cause quant à la première, à qui il a transmis l’herpès et sur lesquelles le virus a eu des conséquences dévastatrices. L’extrait ci-dessous est particulièrement parlant concernant l’opinion du juge quant à la décision R c J.H., et mérite d’être recopié en entier :
« There is nothing even remotely complex about this. It is not rocket science. Whether this issue was or was not a “test case” in previous decisions (and with great respect to both judges in that case, the simplicity of the issues did not call for a “test case”), it is not a test case now. It is, and always has been, a simple proposition that requires no legal acumen but only simple common sense and a modicum of decency: one does not obtain valid “consent” to sexual activity from another person by concealing highly relevant facts that that person is entitled to know and the concealment of which both undermines the right to make an informed and autonomous choice about their sexual integrity and exposes them to horrific, life-changing and life-long consequences. Period. Full stop. End of discussion. Some legal concepts are unavoidably complicated, but if the foregoing proposition needs to be any more complicated than I have expressed it, then, to borrow from Mr. Bumble, “the law is an ass.” Offenders such as Mr. Sawicki, and those who minimize his behaviour as some of his circle very clearly did, merit society’s resounding opprobrium » (para 53).
À ce propos, le juge déplore justement la manière dont plusieurs proches de l’accusé minimisent les actions de celui-ci en affirmant « qu’il a pris une mauvaise décision à un moment difficile dans sa vie, mais qu’il ne faut pas y voir de tromperie malicieuse » (traduction libre, para 26). Il déplore également les propos de sa thérapeute qui continue de parler d’allégations, même deux mois après le plaidoyer de culpabilité. Le juge réitère notamment ceci :
« offenders like Mr. Sawicki, are persons who, whatever else might be said for them, have made a conscious choice to deprive a sexual partner of autonomy over their own sexual integrity and their own health, for the facilitation of their own gratification and damn the consequences for the victim » (para 46).
Le cheminement judiciaire de cette décision sera assurément intéressant et, avec un peu de chance, les principes qui y sont défendus influenceront la manière dont la non-divulgation volontaire des ITSS est traitée par les tribunaux du pays.
Somme toute, il n’est certainement pas simple de se prononcer sur la manière idéale pour traiter de tels cas. Effectivement, bien que l’intégrité physique soit particulièrement protégée en droit (et avec raison), il faut toutefois rester prudent considérant la stigmatisation inhérente à la criminalisation indirecte d’un groupe de personnes déjà vulnérables. Cela dit, la transmission volontaire (ou, à tout le moins, négligente) des ITSS au Canada ne peut continuer d’être excusée telle qu’elle l’est aujourd’hui. Il est grand temps d’agir.
Le sujet de cet article vous a intéressé? N’hésitez pas à consulter nos ressources associées, telles que ce schéma juridique sur le consentement sexuel ainsi que ce résumé de la décision R c Kirkpatrick, 2022 CSC 33.
[1] Tel que cité au para. 43 : K. Czechowski et autres, « That’s not what was originally agreed to » : Perceptions, outcomes, and legal contextualization of non‑consensual condom removal in a Canadian sample, dans PLoS ONE, 14(7), 10 juillet 2019 (en ligne), p. 2.

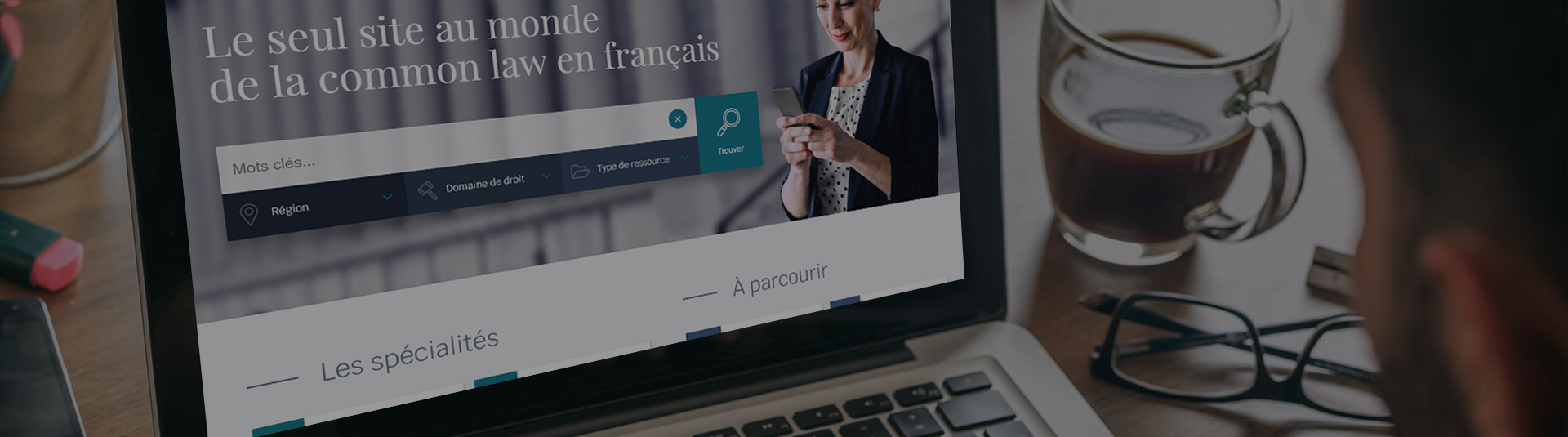
 Arielle Thiffault
Arielle Thiffault